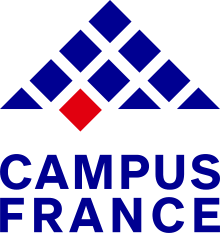International Women’s Rights Day: rights change, and stereotypes are swept away
With the French parliament having just amended the Constitution to include the freedom of women to interrupt their pregnancy, the day of 8 March, International Women’s Rights Day, takes a special turn in France. And it’s a good opportunity to have a look at the past for a few key dates in the progress of women’s rights in France. A slow evolution still marked by gender stereotypes, as show two studies recently released. But initiatives from French advanced schools and schools of engineering try to turn the tide.
La journée du 8 mars 2024 a pour thème Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme. C’est bien de rythme, plus ou moins vif, dont il est question dans la lente avancée des droits des femmes qui s’est accomplie par grandes étapes. Et d’abord, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la Révolution française « ne modifie pas la condition des femmes et ne leur ouvre pas le chemin de la citoyenneté ». Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que les femmes aient en France l’accès à l’instruction et, comme le souligne le site Vie publique, attendre la Première guerre mondiale pour s’apercevoir que les femmes sont devenues « indispensables au bon fonctionnement de l’économie ».
Une chronologie des droits des femmes en France
Après l’ordonnance d’avril 1944 qui accorde le droit de vote et l’éligibilité aux femmes, les choses commencent à s’accélérer. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les revendications des femmes vont porter « sur tous les domaines de la vie sociale, économique et politique et militent pour une réelle égalité ». Quelques grands jalons, une dizaine de dates clés, marquent ces nouvelles revendications et leur traduction par des avancées législatives ou sociales :
- 1946, inscription de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le Préambule de la Constitution ;
- 1965, loi réformant les régimes matrimoniaux : les femmes peuvent gérer leurs biens et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari ;
- 1967, loi autorisant légalement la contraception ;
- 1975, loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ;
- 1982, adoption d'une proposition de la ministre des droits de la femme pour faire du 8 mars 1982 la première Journée pour les droits des femmes ;
- 1983, première loi qui établit l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- 2004, premier plan de lutte contre les violences faites aux femmes ;
- 2006, loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes :
- 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes est déclarée grande cause nationale ;
- 2021, loi qui élargit la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires (PMA).
Une majorité de Français rejette les stéréotypes de genre
Cette chronologie des droits des femmes s’inscrit dans un contexte plus général, celui de l’égalité des genres. A ce propos, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES, qui dépend des ministères de la santé et de l’économie) publie une enquête dans laquelle il apparaît qu’une majorité de Français rejette les stéréotypes de genre. D’après ce baromètre d’opinion, plus d’une personne sur deux en France rejette ces stéréotypes et les clichés de répartition femme/homme, mais une personne sur quatre y adhère et une sur quatre se situe dans une position ambivalente. Toutefois, quel que soit le degré d’adhésion aux représentations stéréotypées, « l’idée que les filles ont autant l’esprit scientifique que les garçons fait très largement consensus dans l’ensemble de la population » !
La publication de cette étude est concomitante à la parution d’une autre étude, celle du ministère en charge de l’égalité femmes/hommes qui publie son ouvrage annuel Chiffres-clés : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, un panorama statistique de référence qui rassemble chaque année les dernières données disponibles sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Selon cette étude, « la lente progression de la part des femmes dans tous les pans de la société française » est effectivement notable. Cependant, « les inégalités et représentations sexistes demeurent », comme en témoignent notamment les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, la part des femmes parmi les cadres dirigeants ou encore la sous-représentation des femmes dans les fonctions politiques et électives. Ainsi, dans le droit fil de l’enquête de la DREES précédente, l’étude du ministère relève également que « l’orientation et l’activité professionnelles restent très empreintes de stéréotypes genrés » : les femmes choisissant des métiers davantage axés vers le soin et le social au détriment des filières d’ingénieur ou dans l’industrie par exemple. Ainsi, comme l’écrit la ministre en charge de l’égalité dans l’édito qui ouvre l’étude, « le combat pour l’égalité doit passer par un changement profond et durable des mentalités pour sortir des stéréotypes qui enferment. Cela se joue dès le plus jeune âge et à toutes les étapes de la vie. Beaucoup a été fait mais il reste à s’attaquer aux racines du problème, aux représentations sexistes, aux inégalités qui persistent, à la place que la société assigne aux femmes ».
Des initiatives pour lutter contre les stéréotypes
Même désir de lutter contre ces stéréotypes dans l’interview que Sylvie Retailleau, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a donné fin février au Point dans laquelle elle milite à son tour « pour une plus grande proportion des femmes dans les carrières scientifiques ».
Selon la ministre, « il subsiste un terrible malentendu qui consiste à faire des mathématiques et de la physique des voies d'excellence, inaccessibles. Il faut d'urgence combattre cette idée. Ensuite, nous avons souvent en tête des représentations obsolètes et déconnectées de la réalité. On s'imagine par exemple les métiers de l'ingénierie (28 % de femmes dans les écoles d'ingénieurs) ou de la tech comme destinés aux hommes. Or c'est faux ». Et la ministre de conclure : « On ne vend pas assez les filières scientifiques comme des ouvertures pluridisciplinaires » !
Deux initiatives vont ainsi en ce sens. C’est d’abord l’opération Ingénieuses 2024, nouvelle édition d’un concours initié par la CDEFI pour l’égalité des genres.
Pour la 14e année consécutive, la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs annonce le lancement de cette opération qui a pour but de rendre les formations et métiers d’ingénieurs « plus mixtes et égalitaires entre les genres ». A noter que le lancement de cette opération intervient au moment où la CDEFI constate que le taux de féminisation a tendance à baisser chez les étudiants dans la tech et le numérique. De son côté enfin, la Conférence des grandes écoles (CGE) organise l’édition 2024 de son Concours Générations Égalité.
Ce concours a pour but « de sensibiliser la communauté étudiante des grandes écoles aux stéréotypes de genre associés à certains secteurs d’activité professionnelle et de la mobiliser autour d’une action d’information et de communication sur les enjeux de mixité des métiers ».
Related contents
- Full timeline of women’s rights on the Vie Publique websitehttps://www.vie-publique.fr/eclairage/19590-chronologie-des-droits-des-femmes
- Retailleau’s interview for Le Point (29 February 2024)https://www.lepoint.fr/sciences-nature/sylvie-retailleau-en-tant-que-femme-j-ai-du-travailler-beaucoup-plus-29-02-2024-2553897_1924.php#11
- CDEFI’s Ingénieuses operationhttp://www.cdefi.fr/fr/actualites/ingenieuses-2024-la-cdefi-lance-la-14e-edition-de-son-concours-pour-legalite-des-genres-dans-les-etudes-et-carrieres-dingenieures
- CGE’s Générations Egalité competitionhttps://www.cge.asso.fr/concours-generations-egalite-2024/
Recommended News