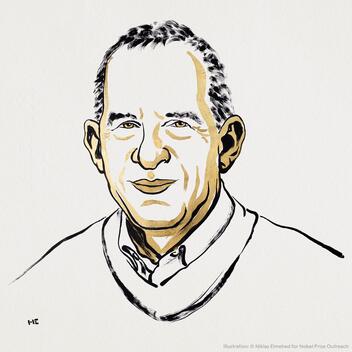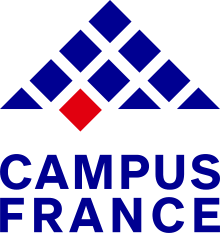L’Année de l’ingénierie : une année pour susciter les vocations
Après la chimie et la physique, c’est au tour de l’ingénierie d’avoir son année ! L’Année de l’ingénierie, lancée officiellement le 1er octobre, va couvrir toute l’année universitaire. Cette opération de promotion a pour vocation de rapprocher les formations, la recherche, les entreprises et le grand public autour des enjeux de l’ingénierie. Soutenue notamment par le ministère de l’enseignement supérieur, le CNRS et les Conférences d’établissements (CDEFI, CGE et France Universités), l’Année de l’ingénierie souhaite valoriser les métiers et les savoirs scientifiques et technologiques pour susciter les vocations et dessiner « un avenir soutenable et responsable ».
Présentée sur le site dédié à l’événement comme une façon de construire l’avenir, l’Année de l’ingénierie est à la fois une année de médiation scientifique au sens large, avec pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre les sciences de l’ingénierie, mais c’est aussi une année d’information ciblée sur les métiers de l’ingénierie et les formations qui y conduisent, jusqu’au doctorat. En ce sens, elle devrait constituer un vecteur efficace d’aide à l’orientation. Pour y parvenir, les organisateurs entendent fédérer différents acteurs, organismes de recherche, établissements scolaires et universitaires, entreprises technologiques, incluant des interventions en milieu scolaire et universitaire, des stages d’immersion et d’autres événements ponctuels.
Un contexte stratégique
Comme le rappelle le site dédié à l’opération, l’Année de l’ingénierie 2025-2026 s’inscrit dans un contexte stratégique où la France investit massivement dans la science et la technologie, à travers des programmes comme le plan France 2030. Face « aux enjeux du changement climatique, aux incertitudes géopolitiques et à la compétition mondiale », l’ingénierie joue en effet « un rôle central pour affronter ces défis et renforcer l’autonomie du pays et sa résilience ».
Le CNRS, partenaire essentiel de l’opération, estime aussi que l’ingénierie et ses sciences visent (au moins) deux enjeux majeurs. Il s’agit en premier lieu de « l’adaptation au changement climatique, et de son atténuation, ainsi que de la préservation des ressources et de la biodiversité, dans un cadre de transitions énergétique et écologique ». Cette politique, observe encore le site dédié à l’opération, repose en particulier sur une large mobilisation des talents dans toutes les spécialités scientifiques et technologiques, à tous niveaux, dans les laboratoires de recherche, les structures d’enseignement, les administrations et dans les entreprises. De nombreux secteurs d’activités sont ainsi concernés, comme ceux de la santé, l’alimentation, l’environnement, l’industrie de transformation, les transports, l’énergie ou les télécommunications… Plus largement, l’ingénierie devrait aussi contribuer au renforcement de l’autonomie stratégique de la France et à la résilience de son économie.
Une dynamisation du secteur
A ces deux enjeux majeurs, s’ajoutent plusieurs objectifs assignés tout particulièrement à l’Année de l’ingénierie pour dynamiser le secteur. Il s’agira notamment :
- de tisser des ponts entre école, recherche et entreprise, en créant « des passerelles concrètes » entre laboratoires, établissements scolaires, universités, écoles d’ingénieurs et entreprises technologiques ;
- de montrer la richesse et la diversité des métiers de l’ingénierie, en révélant « la pluralité des parcours et des métiers de l’ingénierie : recherche, innovation, production, maintenance, recyclage… » ;
- de lutter contre les stéréotypes, en agissant pour l’inclusion et l’égalité des chances dans le monde de l’ingénierie ;
- de susciter des vocations par la curiosité et l’engagement scientifique, en proposant des défis, des rencontres, des ressources pédagogiques et des visites pour remettre « l’invention et la créativité au cœur de l’expérience » scolaire mais aussi universitaire ;
- de favoriser la rencontre entre ingénieurs, chercheurs et grand public, en organisant des conférences, des ateliers, des médiations ou des productions multimédias, pour « rendre visibles celles et ceux qui conçoivent, testent, adaptent et réparent le monde technique ».
Ingénieurs : les chiffres clés de la CDEFILa CDEFI, Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs, a dévoilé en juin dernier son « Panorama des écoles françaises d'ingénieurs » pour l’année académique 2023-2024. Selon ce panorama très complet, on dénombre un effectif total d’environ 257 000 apprenants dans les écoles d'ingénieurs, toutes formations confondues. Parmi eux, quelque 203 000 étudiants étaient inscrits en formation d’ingénieur, tandis qu’un peu moins de 4200 étaient inscrits en cycle Bachelor en sciences et ingénierie. En ce qui concerne l’ouverture à l’international : en 2023-2024, environ 47 400 étudiants étrangers étaient inscrits dans les écoles d'ingénieurs, représentant plus de 20% des effectifs, avec 3% d’étudiants de nationalités intracommunautaires européennes et 17% de nationalités extracommunautaires, issus notamment de pays d’Afrique (66% du total des étrangers admis en 2023). De plus, observe la CDEFI, la moitié des inscrits en mastère spécialisé ou en doctorat est de nationalité étrangère. Par ailleurs, une cinquantaine d’écoles d’ingénieurs sont impliquées dans des campus implantés dans le monde entier, à l’exception de l’Océanie et de l’Amérique du Nord. |
Sur le même sujet
Actualités recommandées