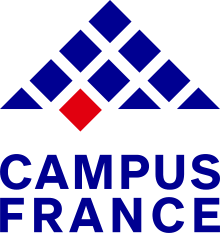L’état de l'emploi scientifique : la France au 7e rang mondial en nombre de chercheurs
Le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche publie une nouvelle édition de « L’état de l’emploi scientifique ». Cette publication statistique de référence biennale a pour objectif de dresser un bilan exhaustif des différents domaines d'activité des personnels qui relèvent de l'emploi scientifique, public et privé, en France. Premier chiffre à retenir : selon cette étude, en 2022, l'emploi scientifique en France s’inscrit en hausse de 0,8% sur un an. La France se situe ainsi au 6e rang mondial en termes de densité de chercheurs et au 7e rang mondial en termes de puissance de recherche avec 333 800 chercheurs.
Au-delà de ces grands chiffres, on retiendra plus particulièrement de cette très riche publication au moins quatre chapitres qui couvrent des domaines emblématiques dans les comparaisons internationales : le nombre d’emplois, l’insertion des docteurs, la part des femmes dans la recherche et la mobilité internationale des doctorants et chercheurs vers la France.
Le nombre et la densité de chercheurs en Europe et dans le monde
En 2021, avec 333 800 chercheurs en ETP Recherche (équivalent temps plein), la France se place au 7e rang mondial, derrière la Chine (2 405 500), les États-Unis (1 639 300) et le Japon (704 500). Mais, au sein de l’Union européenne, la France est le deuxième pays comportant le plus de chercheurs, précédée par l’Allemagne (461 600). Entre les années 2011 et 2021, le ministère de la recherche souligne que les effectifs de chercheurs en France ont progressé de 34%, soit un taux de croissance annuel moyen de 3%. Comparée aux pays mieux classés en nombre de chercheurs, la progression annuelle française est ainsi plus rapide que celle observée au Japon (+0,7%) et du même ordre de grandeur que celle observée en Allemagne (+3,1%).
Selon un autre indicateur, en 2021 encore, la France se situe au 6e rang mondial en termes de densité de chercheurs. Les services statistiques du ministère ont en effet rapporté le nombre de chercheurs à la population en emploi, la France et, avec 12 chercheurs pour mille emplois, la France se place au 6e rang mondial. Selon le ministère, la position française se situe ainsi au-dessus de la moyenne de l’Union européenne et est plus élevée qu’en Allemagne.
Une comparaison internationale de l’insertion des docteurs
Selon la publication du ministère, en 2022, au sein de l’Union européenne, sur 100 adultes âgés de 25 à 64 ans, 16 d’entre eux sont titulaires d’un master et un seul est titulaire d’un doctorat, précisément 1,1% des adultes âgés (1% pour la France).
En termes d’accès à l’emploi, le doctorat offre un meilleur taux que le seul grade de master : en moyenne dans les pays de l’Union européenne en 2022, le taux d’emploi est de 93% pour les adultes ayant un doctorat, contre 89% pour ceux détenant un master ou équivalent.
En France, le diplôme de doctorat favorise quasiment autant l’emploi que dans l’ensemble des pays de l’UE : le taux d’emploi des docteurs âgés de 25 à 64 ans en France est de 92 %, contre 90 % pour les diplômés d’un master ou équivalent. A noter que cet avantage est plus élevé pour les femmes que pour les hommes.
La part des femmes dans la recherche publique et privée
A ce propos, la part des femmes dans les effectifs de la recherche publique progresse, surtout dans les catégories les plus qualifiées et elle progresse également au sein des entreprises.
En 2022, la part des femmes parmi les chercheurs du secteur des administrations s’établit à 41,5 % , mais avec de très fortes disparités selon le type d’établissement. Dans le domaine de la santé, par exemple dans les centres hospitaliers universitaires, cette part est de 57,4%, alors qu’elle n’est que de 41,2% dans les universités.
Au sein des chercheuses en entreprise, la part des femmes est plus faible (23% de chercheuses, 30% de personnels de soutien à la recherche) que parmi les chercheuses du secteur public. Ici aussi, la représentation féminine présente de fortes disparités entre les branches de recherche. L’industrie pharmaceutique et l’industrie chimique sont ainsi les deux seuls secteurs à comptabiliser plus de femmes que d’hommes à des postes de chercheurs.
Les doctorants et chercheurs étrangers en France
« La France pratique depuis des années une politique de rayonnement international de sa recherche », souligne par ailleurs le ministère. Ainsi, la part des étudiants « étrangers mobiles » dans l’ensemble des doctorants a augmenté de manière continue jusqu’en 2009-2010. Aujourd’hui, selon le ministère, « on estime ainsi à 25 200 le nombre d’étudiants étrangers mobiles inscrits en doctorat à la rentrée 2023 ».
Précisément, 42 % des docteurs diplômés en 2018 étaient de nationalité étrangère (tous parcours d’études confondus). Parmi ceux en emploi trois ans après, en 2021 (année perturbée par la pandémie), 53% travaillent en France, 28% dans leur pays d’origine et 19% dans un autre pays. Si l’on considère l’ensemble des chercheurs rémunérés fin 2022 dans le public (y compris les contractuels), 15,1% sont de nationalité étrangère. Parmi eux, 48 % viennent de l’Union européenne mais les deux autres continents principaux pourvoyeurs de doctorants, l’Afrique et l’Asie, sont peu représentés dans les organismes et les établissements d’enseignement supérieur : ces deux continents constituent respectivement 14% et 16% des effectifs totaux de chercheurs étrangers.
S’agissant des entreprises, en 2021, celles-ci emploient 19 300 chercheurs étrangers, soit plus que dans le secteur public. Ces chercheurs étrangers représentent 6,6% des chercheurs du privé, un chiffre en nette augmentation depuis 2015.
Sur le même sujet
Actualités recommandées