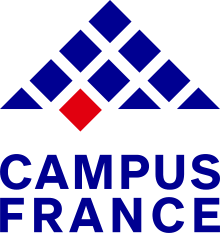Encuesta sobre el doctorado en Francia: miradas cruzadas para una visión más justa
"Miradas cruzadas sobre la oferta formativa doctoral". Así se titula un informe importante que publica la red nacional francesa de colegios doctorales (RNCD en francés), una asociación que trabaja para el reconocimiento del título de doctorado, usando una encuesta de terreno muy completa realizada en el 2021 entre doctorandos y supervisores sobre la oferta formativa doctoral en Francia.
Plus de 11 500 doctorants (français et étrangers) et 5800 de leurs encadrants ont répondu à ce questionnaire qui avait pour principal objectif de fournir un état des lieux du doctorat, avec de nombreux focus sur les doctorants internationaux, et de nourrir la réflexion sur les possibles améliorations de cette offre de formation.
Comme l’écrivent les auteurs du rapport, "la recherche repose largement sur le doctorat". Or, poursuivent-ils, avec 0,6% de docteurs dans la population âgée de 25 à 34 ans, "la France est en recul par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE (0,9%)". C’est donc dans le but de "renforcer la recherche française" et d’améliorer "la reconnaissance et l’attractivité du doctorat en France" que cette enquête a été lancée, dans l’espoir que des progrès surgissent de "la connaissance de ce que sont, aujourd’hui, le doctorat, ses objectifs et ses exigences".
Un constat général satisfaisant
Cette meilleure connaissance du doctorat, des doctorants et de leurs encadrants, passe par un certain nombre de marqueurs qui on été révélés au cours de l’enquête et qui fournissent un état des lieux de la situation. Parmi ces marqueurs, deux points forts :
Le niveau de satisfaction des docteurs
-
67 % des doctorants nationaux estiment que leur expérience correspond à leurs attentes et à leur vision du doctorat et ils recommanderaient même à un ami de préparer un doctorat dans l’établissement dans lequel ils effectuent le leur ;
-
80 % des doctorants, tous domaines confondus, sont satisfaits ou très satisfaits de leur encadrement doctoral ;
-
ils sont 78% à être convaincus de l’intérêt et du sens de leurs travaux et 87 % d’entre eux estiment que c’est "le facteur le plus déterminant pour que le doctorat soit une expérience positive".
Le rôle des docteurs dans la recherche française
-
les réponses à l’enquête montrent que la contribution des doctorants est centrale pour la recherche française : 72 % des encadrants estiment qu’une très grande partie des productions scientifiques dont ils ont été co-auteurs sont associées à un projet doctoral ;
-
les doctorants et leurs encadrants estiment que leurs travaux de recherche menés dans le cadre de leur projet doctoral "constituent l’intérêt principal du doctorat, pour eux-mêmes comme pour la société".
Le profil des doctorants internationaux
Si 67 % des doctorants nationaux sont satisfaits de leur expérience, le taux de satisfaction des doctorants internationaux s’élève quant à lui à 71 %. Un pourcentage très élevé qui montre la bonne expérience que représente pour les étudiants internationaux la formation doctorale en France.
Les auteurs du rapport soulignent en effet que les doctorants se répartissent selon différentes origines :
-
67 % d’entre eux sont nationaux ;
-
33 % sont des doctorants internationaux, parmi lesquels 31 % viennent d’Afrique, 23 % d’Asie et d’Océanie, 20 % d’Europe (15 % venant d’UE et 5 % d’Europe hors UE) et les autres venant d’Amérique centrale et du Sud (11 %) et d’Amérique du Nord (4 %).
L’enquête révèle ainsi que "l’attractivité internationale est différente selon les régions du monde" et que les doctorants internationaux choisissent davantage "le domaine des sciences et technologies, quelle que soit la région du monde dont ils viennent, avec une préférence marquée pour ce domaine parmi ceux qui sont originaires d’Asie et d’Océanie".
Pour les autres domaines, les doctorants internationaux issus d’Amérique du nord et d’Europe choisissent, davantage que les nationaux le domaine des humanités, lettres et langues. De même, les doctorants internationaux européens (hors UE) et d’Afrique choisissent, plus que les nationaux, le domaine des sciences de la société, droit, économie et gestion. Enfin, le domaine des sciences de la vie et de la santé est le plus attractif auprès des internationaux originaires du Moyen-Orient.
Les projets d’installation
Les doctorants ont aussi été interrogés sur leurs parcours et sur leurs projets d’installation après le diplôme. C’est, selon l’enquête, un élément "important à prendre en compte pour la communication auprès des étudiants internationaux et pour l’attractivité internationale du doctorat en France". Leur choix de mobilité vers la France pour effectuer leur doctorat apparaît en effet "intégrer une réflexion sur l’attractivité de la France à beaucoup plus long terme".
La première question qui leur a été posée est celle du pays dans lequel ils souhaiteraient s’installer à terme : pour 45% des doctorants internationaux, le premier choix est de s’installer en France, le cas échéant, après une expérience internationale en post-doc. Ils sont 31% à vouloir s’installer dans leurs pays d’origine et 23% dans un autre pays que la France ou leur pays de nationalité.
L’importance de la langue
Sur le chapitre de la rédaction de la thèse, à noter que 27% des doctorants déclarent ne pas avoir eu le choix de la langue de rédaction de leur thèse. Pourtant, la majorité des encadrants "estiment qu’il faudrait pouvoir choisir au cas par cas la langue de rédaction et, pour le domaine des humanités, lettres et langues, pouvoir aussi choisir d’autres langues que le français ou l’anglais".
Il serait donc utile, estiment les auteurs du rapport, d’affirmer "une position nationale en faveur du sur-mesure et de le faire savoir auprès des étudiants internationaux de pays non francophones, qui semblent privilégier les domaines de recherche dans lesquels ils pourront rédiger leurs thèses en anglais". Le choix de la langue de rédaction semble ainsi "motivé d’abord par la maîtrise de la langue de rédaction, d’une part par le doctorant et, d’autre part, par ses encadrants qui sont amenés à la lire et à la corriger". En outre, elle est également motivée "par la volonté de lui donner plus de visibilité à l’international".
Le contexte de la crise sanitaire
Parmi tous les nombreux autres points soulevés, notamment le financement des études et l’avenir professionnel, le rapport s’attache à développer le contexte de la crise sanitaire et l’accompagnement qui a pu être apporté aux doctorants durant cette période difficile. La majorité des répondants est satisfaite de cet accompagnement et, comme le note l’étude, "les étrangers sont plus satisfaits que les Français", particulièrement les doctorants venant de la région Asie Pacifique. D’autant que, selon l’enquête, la population doctorante semble avoir été plus exposée au Covid que la population nationale !
Parmi les doctorants, 47 % d’entre eux déclarent en effet avoir souffert d’isolement. Là encore, selon l’enquête, ce sentiment d’isolement a beaucoup plus affecté les doctorants étrangers que les Français. Les vagues de Covid et les fermetures des frontières qui en ont résulté ont touché "les différentes régions du monde de manière décalée. Les plus touchés par la maladie comme par le sentiment d’isolement ont été les doctorants du Proche et du Moyen-Orient"
.
Artículos relacionados
Noticias recomendadas